
« Les Etats-Unis vont prendre le contrôle de la bande de Gaza », qui pourrait être « transformée en Riviera du Moyen-Orient ». « Ridicule » et « absurde », « toute idée de ce genre est de nature à embraser la région ». En ce matin du 5 février, qui de Sami Abu Zuhri, l’un des dirigeants du Hamas, ou de Donald Trump, président des Etats-Unis d’Amérique, apparaît le plus sensé ? Ce n’est certes pas l’objet de la « stratégie du fou », destinée à mettre en scène l’imprévisibilité du dirigeant, mais c’est l’un de ses effets. Si l’on veut bien excepter Nixon, qui lui a donné son nom, la liste des dirigeants auxquels on impute un recours à cette stratégie place d’ailleurs Donald Trump dans une lignée édifiante : Nikita Khroutchev, Saddam Hussein, Mouammar Kadhafi, Kim Jong-Un voire Vladimir Poutine… Cette stratégie a pourtant encore ses soutiens, spécialement de ceux qui, peu confiants dans leurs capacités d’élaboration, se résignent à déplacer leur centre de décision dans des attributs censés rassembler en bien peu de place la force, le bon sens, le courage et, pour faire bonne mesure, l’amour de la patrie.
Une revue de pratiques peine pourtant à en démontrer l’efficacité. A tous seigneurs tous honneurs : Saddam Hussein et Mouammar Kadhafi ne sont plus là pour dire le contraire. Mais plus encore, il faut lire le constat que dresse Roseanna McManus dans la revue Foreign Affairs, dès avant les déclarations sur Gaza. Car Trump, dans son premier mandat, n’a rien obtenu de Kim Jong-Un après l’avoir menacé des feux de l’enfer puis avoir déclaré qu’ils étaient mutuellement « tombés amoureux ». Rien obtenu en Afghanistan après avoir à la fois largué sur le pays la « mère de toutes les bombes » et engagé des pourparlers de paix avec les Talibans. Rien de l’Iran, après avoir ordonné une frappe et l’avoir annulée. Sur tous ces fronts, il s’est avéré aussi imprévisible qu’impuissant. Quant à Nixon, il a in fine évacué le VietNam, et Khroutchev a reculé face à Kennedy.
Les limites de cette stratégie sont multiples. La première est qu’il est difficile pour un chef d’Etat de convaincre ses homologues de sa parfaite irrationnalité, au préjudice de son crédit politique et de celui de son pays – tout en renforçant bien inutilement celui de ses adversaires, tel le Hamas. La deuxième réside, inversement, dans sa raison d’être : comment croire à la parole d’un homme, et d’un Etat, qui fait profession d’imprévisibilité ? Comment donner crédit aux garanties qu’il doit conjuguer aux menaces qu’il profère ? Et comment convaincre que l’on renoncera effectivement à la force brute lorsque l’on s’applique à donner des gages de folie ? Les partisans de Trump veulent croire qu’il s’agit bien d’une stratégie, non d’une pathologie. Dans ce dernier cas, ce serait terrifiant. Dans le premier, c’est inopérant. Rien, en tout cas, qui doive convaincre de délocaliser à notre tour nos centres de décision.
Illustration ; IA française Mistral
Chronique du 12 février 2025. Depuis…
En savoir plus sur Koztoujours
Subscribe to get the latest posts sent to your email.








![[Tribune] Laissons les députés voter en conscience](https://www.koztoujours.fr/wp-content/uploads/2025/02/pasdacc_pt-45x45.jpg)
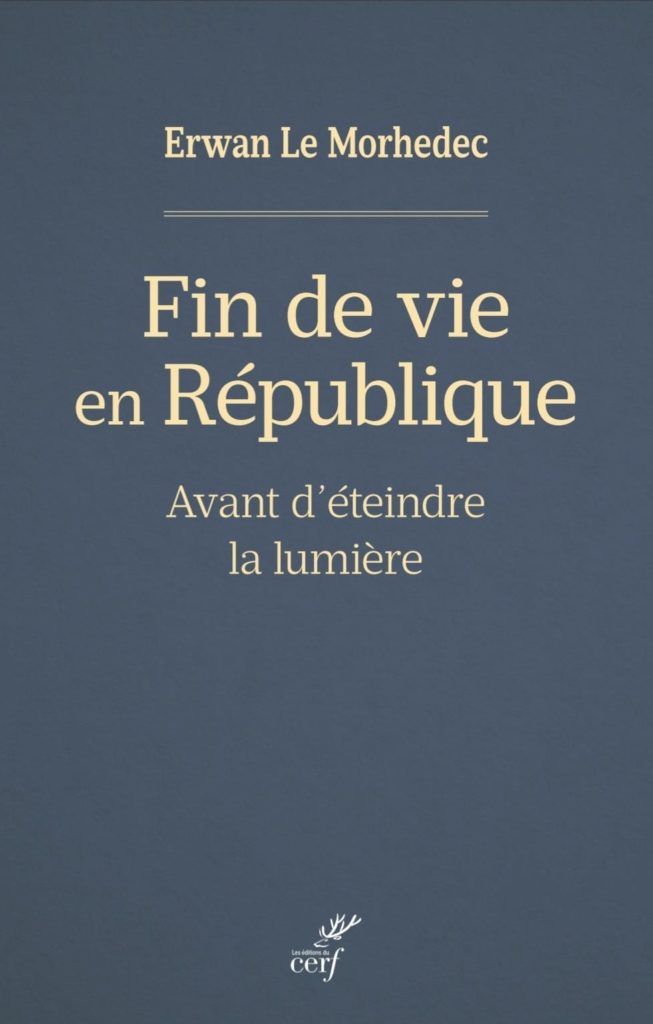

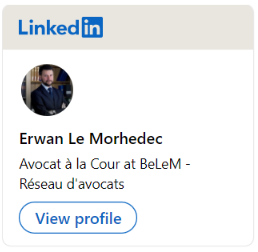


Analyse très probablement juste, et il faut espérer qu’elle le soit.
Dans l’immédiat seul un comportement responsable d’un nombre limité de républicains, sénateurs ou membres du congrès, permettra de limiter les conséquences désastreuses du comportement présidentiel, compte tenu des majorités limitées dans les deux chambres.
Il convient également d’espérer que la majorité conservatrice á la cour suprême ne sera pas entièrement à la botte du président.
Je ne sais pas si l’alignement sur les rêves israéliens est si imprévisible que cela. Après tout, c’est la politique systématique des gouvernements états-uniens depuis la fin du mandat Carter, qui a soutenu le retour à la légalité internationale pour l’Egypte (horresco referens ! « non-acquisition de territoires par la force » ? Bah !).
Certes, vider la population de Gaza est absurde et totalement illégal, mais pas forcément tellement plus qu’en 1982 de soutenir l’invasion du Liban pour « venir en aide aux chrétiens libanais menacés de génocide », en oubliant le million et demi de chiites du Sud-Liban… on en voit les résultats, quand on crie que le Hezbollah est méchant. Alors que les Chiites auraient dû se féliciter de cette invasion au nom de la lutte contre « l’OLP nazi » et « les bêtes à deux pieds » palestiniennes (sic, Begin 1982).
Bref, je vois plus de continuité dans la politique de nos amis des EU que de rupture : il quitte l’Accord de Paris ? Clinton a refusé le protocole de Kyoto ! Il fait du protectionnisme ? allons, qui ne sait que les industries EU sont largement soutenues par commandes et subventions ! il abandonne l’Europe ? parce que le Big Switch face à la Chine n’a pas été largement lancé par Obama ? Il n’aime pas les institutions internationales ? On reparle des bombardements en Irak de la guerre de Monica, de l’invasion de l’Irak de 2003, des assassinats par drone de note copain Barack ?
Vous avez en bonne partie raison (si ce n’est que ce n’est pas Clinton qui a refusé le protocole de Kyoto) et nous payons aussi une forme d’incrédulité et d’inertie. Il est évident aussi que les Etats-Unis ont toujours défendu férocement leurs propres intérêts – utilisant aussi leur puissance économique pour imposer leur politique aux autres acteurs. Mais il est indéniable qu’il y a une brutalité dans la rupture d’un dirigeant qui ne se contente pas de réorienter sa politique mais opère un lâchage en rase campagne de ses alliés – le tout agrémenté d’insultes, de mépris pour toutes les règles et conventions, pour la démocratie, pour ceux qui la défendent etc.
Difficile aussi de nier la rupture radicale avec la politique de Biden – que ce soit vis-à-vis de l’Ukraine, de l’Accord de Paris etc
Je ne sais pas s’il est trop pertinent de pinailler sur le sujet : Clinton a signé le texte et n’a jamais cherché à le faire ratifier. Je trouve que ma lecture se vaut, mais après tout on peut aussi se dire qu’il a juste manqué de temps ou que la majorité était, effectivement, républicaine. Ca me fait penser à Wilson, lui non plus n’a pas fait ratifier un traité… enfin, lui a essayé vraiment.
Sur la différence entre l’actuel et l’ancien, et toujours en lien avec l’environnement, Biden avait relancé les forages pétroliers en 2022 et 2023 pour faire baisser le prix de l’essence. Et maintenant, drill, baby, drill !
Cependant, à Dieu ne plaise que je nie la différence entre les 2 ! Les plus importantes, à mes yeux, sont le côté souveraineté infâme, comme Caligula, Néron, Héliogabale l’avaient incarné (vulgaire, beauf, méprisant, imbu de lui-même)… et, c’est vrai, la trahison en rase campagne de l’Ukraine. Le reste me semble surtout de la gesticulation, de la com’… et la volonté de prendre le contrôle du Panama ou du Groenland n’est pas très éloignée de pratiques anciennes (débarquement à la Grenade, sanctions économiques et politiques contre le Venezuela, blocus de Cuba), dans la lignée de la doctrine de Monroe.