Une semaine après, le verdict ne passe pas. Ils peuvent dire le contraire, ils peuvent l’écrire et travestir la réalité jusque dans une décision rendue au nom du peuple Français. Ils peuvent dire qu’un meurtre n’en était pas un, que sept meurtres n’en étaient pas, parce que leur auteur était quelqu’un de bien. Mais ils mélangent justice et compassion, tout à la confusion sentimentale qui caractérise notre société.
Dans cette si grave affaire, après le verdict, les jurés se sont attardés.
A la foule qui acclamait cette décision qui aurait due être accueillie avec retenue et dignité, ils ont souri, ainsi qu’au médecin.
Étaient-ils encore du côté de la Justice ?
J’ai pensé à la famille Iramuno, qui devait se sentir bien seule dans la foule. Comment est-elle repartie ? Quelqu’un s’en est-il seulement soucié ? Quelqu’un a-t-il eu un regard pour eux ? Un mot, une attention ? Car parmi toutes les familles, une seule, la famille Iramuno, s’est portée partie civile avant le procès, et lâchement on s’en satisfait. Pourtant, cette famille est écartée, oubliée et niée. Pour un peu, on en voudrait à ce fils unique qui voulait simplement vivre les derniers instants de sa mère. Que n’a-t-il validé la fin précipitée de son proche, comme les autres ? Lui aurait simplement voulu que le Docteur Bonnemaison lui parle. Il ne l’a pas jugé utile. Il ne lui a même pas parlé, pas plus qu’il n’a parlé aux autres familles. Il n’a pas jugé nécessaire de les consulter, les prévenir, ou les préparer.
Ainsi, un matin, vous tenez la main de votre mère et l’après-midi, elle est morte, sans vous. Parce qu’un médecin a considéré, seul, qu’il fallait abréger la vie de votre mère, pourtant paisible.
Une société saine devrait être derrière ce fils et sa demande simple, si simple, une demande d’une humanité essentielle qui vient du fond des âges : tenir la main de sa mère pour son dernier soupir.
Ce n’est plus le cas dans ce qu’est devenue notre société, et la compassion va à ces familles qui ont toutes considéré que cela avait suffisamment duré, peut-être par épuisement physique et nerveux, peut-être par lassitude, peut-être parce que ces proches n’en finissaient pas de mourir. Dans une autre société, on aurait peut-être eu le tort de trop les accabler. Dans notre société, nous avons le tort de trop les exonérer.
Cette excuse des familles rétrospectivement consentantes[1] est une lâcheté et une monstruosité juridique. Le consentement de la victime n’est jamais exonératoire en droit pénal – car c’est la société qui est en jeu – et l’on parle ici du consentement d’un tiers. Et pour parler d’un consentement, encore faudrait-il seulement qu’il ait été donné avant la décision.
Tout le monde veut arriver à temps auprès de ses proches pour leurs derniers instants. Nicolas Bonnemaison ne l’a pas permis.Je me retiens de laisser libre cours à ma colère mais, aussi bien intentionné ait-il éventuellement pu être, c’est la colère qui me prend lorsque je lis qu’à ce fils, le docteur Bonnemaison répond : « j’aimerais vous faire comprendre ce qui a dicté mon choix. Vous êtes en souffrance parce que vous n’avez pas compris« . Non ! Il est en souffrance parce que vous avez choisi seul, parce que vous n’avez pas imaginé le consulter, parce que vous leur avez « volé les derniers instants » !
Ces derniers instants sont peut-être épuisants à attendre, mais c’est précisément parce qu’ils sont si essentiels que l’on s’épuise à les attendre. C’est pour cela que la très grande majorité des médecins vous appelleront en pleine nuit pour vous dire : « maintenant, il faut venir« . Combien de personnes vous diront encore, des années après le décès d’un proche : « j’aurais tellement voulu être là avec lui » ? Combien vous confient, abattus : « et je n’étais même pas là » ? Une autre famille l’a d’ailleurs dit : « c’est allé très vite, j’aurais aimé le voir partir« . Comment un médecin peut-il s’immiscer dans ce moment ?
La mort a aussi une part mystérieuse qui donne un sens à ces derniers instants. Il faut savoir respecter le temps de mourir. Dans la mort intime, Marie de Hennezel raconte ces fins de vie qui prennent sens dans leurs tous derniers instants. Elle raconte par exemple la mort de Valérie, qui exprimait son désir de mourir juste avant de tomber dans le coma. Oh là, le désir de mourir était clair et formulé. Mais Valérie ne meurt pas. Médicalement pourtant, elle ne devrait plus survivre. Marie de Hennezel interroge sa mère : « y a-t-il quelqu’un dans votre entourage qui ne soit pas prêt à la mort de Valérie ?« . Mais sa mère ne voit personne. Et puis le lendemain, elle qui « ne réagit plus depuis longtemps, ni quand on l’appelle par son prénom ni quand on la touche« , reçoit la visite de ses parents et d’un bénévole qui s’était beaucoup attaché à elle. Ensemble, ils l’ont remercié pour sa vie, ce qu’elle leur avait donné.
A cet instant précis, Valérie est sortie de son profond coma. Elle a ouvert les yeux, a regardé ses parents. Puis elle leur a fait un petit signe de la main, en disant « ciao », d’une manière un peu désinvolte, comme elle le faisait toujours, et son souffle s’est suspendu sur ce dernier au revoir. C’était fini.
Alors même que le Docteur Bonnemaison avait affaire à des cas moins critiques, que serait-il advenu de Valérie si elle avait été dans son service ? Ces moments, cette libération, auraient-elles pu avoir lieu ?
N. Bonnemaison a reconnu que ses actes entraînaient immanquablement la mort. La Cour d’assises, elle, a jugé qu’il n’avait pas l’intention de la donner.La Cour a retenu que « Nicolas Bonnemaison a procédé lui-même à des injections, qu’il n’en a pas informé l’équipe soignante, qu’il n’a pas renseigné le dossier médical de ses patients et qu’il n’a pas informé les familles à chaque fois« . Mais elle a estimé qu’il n’avait pas eu l’intention de donner la mort. Sept fois. A six reprises, il procède pratiquement au même acte, à six reprises ses patients meurent, et à la septième, il n’a pas l’intention de donner la mort ? Alors même qu’il maquille ses actes, n’informe personne, ne tient pas à jour le dossier médical ?
Alors qu’en fin de vie, une sédation pouvant entraîner la mort est acceptée par la loi, est-ce la démarche d’un homme qui n’est pas conscient de l’acte qu’il pose ?
Joséphine Bataille rapporte ce moment crucial de l’audience :
Bonnemaison savait ce qu’il faisait — il abrégeait volontairement des agonies, il savait qu’il enfreignait la loi. « J’ai agi en conscience, mais je sais que je serai condamné. Car sinon, cela légaliserait l’euthanasie », avait-il déclaré à Roland Coutanceau, l’expert psychiatrique. La Défense s’appliquant à montrer que Bonnemaison n’avait fait qu’appliquer la loi, ce propos rapporté était assez confondant pour que le juge réagisse pendant l’audience. Et il avait réagi, faisant lever l’accusé. Qui avait confirmé.
Autre moment-clé, que rapporte Joséphine Bataille (comme Pascale Robert-Diard), cet échange entre Nicolas Bonnemaison et l’Avocat Général :
– Vous êtes d’accord qu’injecter du curare n’est plus un acte de sédation ?
– Non, on est dans l’acte de mettre fin à une terrible agonie, c’est bien mon état d’esprit
– Vous êtes d’accord que l’utilisation de ce curare n’est pas autorisé par la loi dans ces conditions là ? Que vous entraînez immanquablement la mort ?
– C’est là qu’on peut poser la question de la loi Leonetti…
– Je repose ma question sur le curare : si vous en injectez à une personne, va-t-elle, oui ou non, mourir ?
– Oui, effectivement
Peut-on écrire, dans une décision de justice, au nom du peuple français, que l’homme qui injecte du curare dans ces circonstances, en confirmant que la personne à laquelle elle injecte ce produit va mourir, n’a pas l’intention de donner la mort ?! Peut-on aller contre son intention déclarée ? Peut-on écrire dans un arrêt d’assises le contraire de ce que déclare l’accusé ?
Autre point : la Cour écrit qu’il a « estimé de bonne foi que ses patients souffraient physiquement et psychiquement« . Il faut comprendre ce qu’on lit ici : s’il a dû estimer que tel était le cas, c’est bien parce que cela n’était pas manifeste. Le Docteur Bonnemaison ne se trouvait pas dans cette situation dans laquelle un malade se tord de douleur : certains de ses patients étaient paisibles. Il était de surcroît dans une unité d’hospitalisation de courte durée. Et, même face à des patients paisibles, il a estimé qu’ils souffraient. Il a, ainsi, déclaré qu’« il n’est jamais certain que les patients ne souffrent pas psychiquement de se voir mourir, même s’ils sont dans le coma » et, dans le cas de Madame Iramuno, qu’il avait agi parce qu’il y avait « un risque de souffrance psychique« . Un risque !
Voilà les contorsions auxquelles se livre la Cour d’assises, sans compter que le recours à la bonne foi en la matière est douteux.
Il y a enfin la personnalité de l’accusé. A la différence d’une Christine Malèvre, qui paraissait mue par un sentiment de toute-puissance, le docteur Bonnemaison est précisément décrit comme un médecin particulièrement humain. Un médecin rare, qui sait prendre le temps de s’arrêter avec les malades et de les écouter (sauf, à tout le moins, à sept occasions). Un médecin qui aurait agi, nous dit-on, par compassion, mais une compassion « pas assez lucide, qui prétend se charger pour les autres d’un fardeau qui leur appartient…»
La dérive d’un soignant tout-puissant, d’un médecin trop comptable est inquiétante. Mais un médecin mal compatissant aussi peut vous tuer sans votre avis.Alors oui, on juge un homme, pas un principe. Et cette motivation est cruciale dans la sanction infligée Les débats ont mis à jour le fait que les ressorts de ses actes étaient louables, mais mal dirigés. Alors évidemment, oui, dans un tel cas, la sanction doit être adaptée : qu’il s’agisse d’une dispense de peine, d’un sursis total, ou d’une peine symbolique. Mais se contenter d’estimer que, parce que l’homme a agi par compassion, alors il n’est pas condamnable, c’est commettre une terrible erreur.
C’est oublier précisément qu’il est là aussi, le pire risque de dérive euthanasique : dans l’acte qu’un médecin, seul, fragile peut-être, va accomplir parce que, pour les meilleures raisons du monde, il aura considéré que c’était assez. De bonne foi, peut-être, dans le meilleur des cas. Mais à tort aussi. Et lorsque, me lisant, vous contestez le risque d’être un jour euthanasié contre votre volonté, il est aussi là, ce risque. Très présent, très actuel. Et la Cour n’y a rien trouvé à redire.
Que dira-t-on demain au médecin qui, lui, fera face à une agonie longue, difficile, douloureuse, et décidera seul de mettre fin à la vie d’un homme ?
Je vais mourir un jour. Je peux mourir demain. Un médecin pourrait décider que je souffre trop, que mes proches souffrent trop, voire simplement que je risque de souffrir, et mettre un terme à ma vie sans que je revoie mes proches ou qu’ils soient présents.
Un jour, comme Pierre Iramuno, j’accompagnerai mes parents à l’hôpital. J’aimerais pouvoir leur tenir la main dans leurs derniers moments. Je veux que mes parents sachent qu’ils peuvent compter sur moi. Mais, le temps d’une absence, un médecin pourrait en décider autrement, parce qu’il aura estimé que c’était mieux ainsi.
Et pour la Cour d’assises de Pau, ces médecins auront bien fait.
- Elle n’est pas reprise dans la décision, mais elle l’est beaucoup, y compris par des professionnels. [↩]
En savoir plus sur Koztoujours
Subscribe to get the latest posts sent to your email.





![[Tribune] Laissons les députés voter en conscience](https://www.koztoujours.fr/wp-content/uploads/2025/02/pasdacc_pt-45x45.jpg)





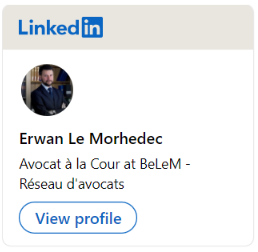


Voilà. Merci.
De la part d’une fille qui a compris durant ce procès et les débats sur l’Hypnovel que, si elle n’était pas là le jour fatidique alors qu’elle avait dit 20 fois aux infirmiers et médecins de l’appeler à toute heure du jour et de la nuit parce qu’elle voulait être là, ce n’était pas la « faute à pas de chance » mais parce que personne ne lui a dit que ce médicament qu’on était en train d’administrer à sa mère la dernière après-midi qu’elle l’a vue « pour l’apaiser » la ferait assurément mourir dans les 24 heures… Je ne leur en veux pas de l’avoir apaisée. Je leur en veux de ne pas m’avoir prévenue de ce qui se passait. Je leur en veux qu’elle ait été seule. Ce n’est pas parce qu’on ne croit pas en Dieu qu’on n’a pas besoin de dire adieu.
Je pense que les juges ont aussi fait la confusion entre l’acte de faire mourir et la raison qui fait le meurtre.
questions à l’avocat :
La partie civile en assise peut-elle faire appel ?
Cet appel vaudra-t-il pour les 7 homicides ?
(Je n’ose imaginer que le parquet fasse appel)
Non, une partie civile ne peut pas faire appel. On attend la décision du parquet.
@ Thaliane : indépendamment du sujet même de l’euthanasie, je ne comprends pas que des soignants puissent écarter la famille. Ne pas, au contraire de ce qu’ils ont fait là, prévenir la famille de, justement, rester. Combien de familles ne comprendraient pas que, même si le médicament risque d’abréger un peu la vie, il va surtout apaiser leur proche ?
Nicolas Bonnemaison a admis s’être trompé dans le cas de la famille Iramuno, et avoir généré de la souffrance, sans que cela ne remette en question manifestement l’opportunité de le faire dans d’autres cas. Est-ce vraiment ce médecin si humain, si fin, qui ne comprend pas qu’en privant un fils d’assister sa mère jusqu’à son dernier souffle, il risque de causer une souffrance pour longtemps, ce dont vous témoignez d’ailleurs ?
Thaliane a écrit :
Evidemment. Personne ne veut que ses proches meurent seuls. Cette insensibilité s’explique certainement par une forme de routine, dans le milieu hospitalier, mais ils devraient la combattre .
Thaliane a écrit :
Qui sait ? Au contraire, même, peut-être ?
La question de l’appel me parait effectivement déterminante pour évaluer la portée de l’évènement. Qu’un tribunal emette une conclusion absurde, une fois, surtout avec un jury populaire, j’imagine que ça peut arriver.
Ce serait bien plus grave que le Parquet ne trouve rien à redire, ou au moins à rediscuter face à une telle décision. Au delà du sujet grave de la fin de vie, ce serait un piétinement du droit et de la raison au nom de l’émotion populaire.
@ Vivien : « un tribunal« … Pour info, il y a encore 10 ans, il n’existait pas d’appels aux Assises.
@ remseeks : des précisions sur l’appel. Une partie civile peut faire appel, en fait, mais si elle est seule à le faire, son appel ne concerne que les dommages-intérêts (inexistant en l’espèce).
Vivien a écrit :
Oui. Je crains qu’il ne le fasse pas, pourtant.
Le jugement, les applaudissements, les commentaires m’ont fait et me font HURLER. Achever coûte moins que soigner et accompagner. Achever par compassion ? Pour QUI ?
Un verdict indéfendable.
Accueilli dans la liesse.
Et le pire est probablement à venir.
Quand il n’y a plus guère d’espoir, reste l’espérance.
l’incohérence d’un verdict à l’OJ Simpson, donc : non coupable au pénal mais meurtrier au civil …
Merci de ces précisions
Question aux juristes (à commencer par koz bien sûr): qui établit au cours du délibéré la liste des questions auxquelles les jurés doivent répondre? Parce que ma conviction est que les jurés ne parvenaient pas à répondre « oui » à a question « l’accusé a-t-il volontairement donné la mort », sans avoir le sentiment de valider qu’il est un assassin de polar.
Dans le même ordre d’idées, est-il rappelé aux jurés qu’ils peuvent prononcer une dispense de peine? Si cela n’est pas fait, je pense que ça pousse des hésitants à mélanger qualification de l’acte et condamnation.
Je précise que je pose ces questions tout en estimant profondément incohérente la réponse des juges qui excusent, dans leur motivation, un acte dont ils viennent par l’acquittement de nier qu’il ait eu lieu. Je me demande seulement si, dans les processus d’une délibération d’Assises, il est possible pour un magistrat de cadrer les problématiques, ou s’il se défend de toute influence professionnelle devant le jury souverain même quand celui-ci va tout droit vers une décision incohérente.
Il est certain que les jurés sont tenus par la question posée : si la personne est accusée d’homicide volontaire, il ne leur appartient pas de requalifier en homicide involontaire. Après, c’est le rôle de l’avocat général et des avocats des parties civiles de faire comprendre les nuances du droit, ce qu’a en grande partie fait l’avocat général dans ses réquisitions. Au cours du délibéré, en revanche, c’est le rôle du président que d’éclairer sur le droit, la possibilité d’une dispense de peine, les réductions de peine etc.
Par ailleurs, les magistrats composant la Cour votent également.
Médecin, ayant été confronté souvent à la fin de vie, ce verdict me déplait fortement.
Rien ne justifie la mise à l’écart des plus proches, enfants, parents…..
La mort ne doit pas être volée, ma mère est morte d’un cancer, j’ai été heureuse de pouvoir l’accompagner jusqu’à son dernier souffle. Cela m’a beaucoup apaisé.
@ Koz:
Ca signifierai aussi qu’il y a une hiérarchie pour les manières et les raisons de le tuer ? Certaines seraient condamnables, d’autres non. J’hallucine !
à Koz
Je suis surpris par la violence du propos tenu par l’ex docteur Bonnemaison, que vous citez : « j’aimerais vous faire comprendre ce qui a dicté mon choix. Vous êtes en souffrance parce que vous n’avez pas compris ». La compassion, dans le cas présent, n’entre pas – loin de là – en contradiction avec le délire de toute puissance: bien au contraire! c’est au nom de la compassion qu’il s’est cru légitime pour décider seul de la vie ou de la mort de ses patients ; toujours au nom de la compassion il se croit permis de faire la leçon au parent d’une de ses victimes. Alors, si le docteur Bonnemaison est sincère, il faut bien reconnaître qu’il s’agit d’un déséquilibré. Rien à voir avec le type de compassion que l’on rencontre habituellement chez les infirmières et les médecins, en particulier dans les unités de soins palliatifs.
En tout cas, j’espère qu’il a partagé son « gâteau au chocolat » avec l’équipe soignante.
La loi actuelle (loi pénale) interdit le meurtre et l’assassinat et les réprime. Je suis assez heureux de cette loi !!!. Et il me semble normal que l’on protégè aussi les personnes en fin de vie des agissements des meurtriers, que ceux-ci agissement avec des bons sentiments ou des mauvais. La loi ne réprouve pas les sentiments, mais les actes et les intentions qui les gouvernent (bon je ne suis pas juriste, et on doit pouvoir formuler cela de manière plus adéquate).
J’espère pour moi et mes proches que nous ne soyons jamais dans les mains d’un médecin agissant comme le Dr Bonnemaison. Oui aux soins palliatifs, non aux meurtres par compassion. Je dénie à quiconque le droit d’agir envers moi comme si j’étais un sous-homme ou comme on dit « un légume », même au cas où, un jour, je serais handicapé et/ou inconscient suite à une maladie ou un accident. Je dénie à quiconque le droit de me faire une piqûre de curare, de potassium ou d’une dose d’un sédatif très au delà de ce qui est nécessaire pour une sédation faite suivant les bonnes pratiques médicales : un sédation n’a pas pour but de tuer et elle ne le fait pas si les doses sont respectées. Idem pour les antalgiques.
A terme, de tels actes fragilisent la confiance entre malades et soignants, celle entre familles et soignants, mais aussi la confiance interne aux équipes soignantes.
« le progrès n’est plus dans l’homme »
( Georges Bernanos)
Le Parquet fait appel, ouf !
La région Ile de France suspend les subventions à Gerson. Il va falloir retourner dans la rue…
Je lis votre article avec un certain soulagement – dans cette espèce de liesse populaire à laquelle je ne comprends rien, je me sentais très seule. Je ne considère même pas qu’il s’agit là d’un sujet lié à l’euthanasie ; je trouve simplement terrifiante l’idée que, le jour l’on est vieux et malade et qu’on doit vous hospitaliser, les médecins censés vous soigner, ou du moins si ce n’est plus possible, de rendre vos derniers moments moins difficiles, décident que vous risquez de trop souffrir (trop, selon l’échelle de valeur de qui ?) et mettent fin à vos jours unilatéralement.
Je trouve cette idée terrifiante pour mes proches, et je la trouve terrifiante pour moi-même : en poussant le raisonnement à l’extrême, comment aller à l’hôpital en confiance, puisqu’il est admis que les médecins puissent vous assassiner par « compassion », sans en parler à personne, comme ça, parce qu’ils l’ont décidé ??? On n’est pas dans l’euthanasie, là ; quelle que soit mon opinion sur l’euthanasie (qui n’est pas franchement favorable), je peux entendre la notion d’une concertation médecins / famille / patient dans certains cas spécifiques. A la limite. Ici, on est dans l’assassinat pur et simple.
Quant à la négation de la souffrance de la famille Iramuno, je la trouve répugnante. Ils sont en minorité nous dit-on ? Mais quand bien même ils seraient un parmi cent, ce serait encore trop !
Heureusement que le parquet fait appel !
Blaise Join-Lambert a écrit :
Cette réponse est en effet, au minimum, ambigüe. Sans l’intonation et le contexte, rien n’est certain. Mais, je suis d’accord avec vous, en fonction de la façon dont il a été dit, cela peut également être d’une incroyable suffisance. Et l’on se demande quelle est la véritable erreur qu’il confesse. Celle d’avoir procédé à cet acte ou de ne pas avoir pris le temps d’expliquer. En tout état de cause, il ne reconnaît pas les six autres « erreurs » car il agit manifestement au gré de son inspiration. Ce n’est que le hasard ou les probabilités qui font qu’il cause ou non des souffrances psychiques aux proches. Et c’est encore sans compter les victimes. Des victimes qui ont été totalement oubliées parce que, presque mortes, elles ne seraient presque plus victimes.
@ Bobby,
@ Aurélie : il y a effectivement un vrai problème de confiance à l’égard des soignants. J’en connais des pelletées qui font ce métier avec de vraies convictions humanistes. Mais je ne peux pas me porter garant de tous, et clairement, je ne le ferais pas. Aujourd’hui, je comprendrais parfaitement qu’une personne âgée malade ait peur d’entrer à l’hôpital.
Aurélie a écrit :
Je suis totalement d’accord avec vous. C’est bien ce que je trouve détestable dans ce traitement : ils ont l’attitude normale d’une famille équilibrée. Ils ne sont même pas spécialement vindicatifs. Ils n’acceptent simplement pas qu’un médecin décide seul de tuer leur proche un après-midi, alors qu’ils étaient à l’hôpital le même. Et pourtant, on les regarde comme « la seule famille qui s’est portée partie civile avant le procès ».
Je viens de lire ceci, extrait de « Trahison de l’occident » de Jacques Ellul.
Le passage concerne l’évolution de la perception du bourreau par la société. Ellul en arrive à aujourd’hui soit 1974 (la peine de mort n’est pas encore abolie).
Le texte avec le mot final sur l’archange m’a frappé.
« Il n’y a plus de mystère du bourreau, proclamait la raison, il y a cinquante ans. Il y a encore un mystère du bourreau, affirme notre temps, mais combien rassurant et beau. Car le bourreau n’est plus chargé que d’une « liquidation physique ». Et ce terme n’est pas simple hypocrisie, euphémisme de la société technicienne. Il implique justement que le condamné est déjà mort. Il est hors la vérité, hors la justice et de ce fait n’existe plus. Il n’a plus de vie personnelle, ni spirituelle, il n’est qu’une survivance, une persistance d’organes physiques qui n’a plus de raison. Le bourreau remet les choses en ordre ; à la mort répond par sa main la mort. Et dans son rôle, nouveau signe des nouveaux mondes, la lumière éclatante et froide de la salle d’exécution lui fait des apparences d’archange ».